Dans le creux du monde, en son centre, gît une singularité, sphère cosmique, extrait de matière spatiale, extra-terrestre qui, comme l’antique monolithe, ce pionnier des objets stellaires cinématographiques, incarne le phénomène physique environné de métaphysique. L’astéroïde du film donne son nom à la ville mais aussi à l’oeuvre elle-même et renseigne déjà, en ce sens, la structure métadiégétique et post-moderne du nouveau film de Wes Anderson. Autour du cratère, ce vestige de la chute, qui est aussi une rumeur de l’explosion nucléaire, son inversion matérielle et formelle, gravitent des personnages qui, peu à peu, vont faire communauté. C’est en un sens le point de départ d’Asteroid City envisagé comme pièce de théâtre, monde de fiction à l’intérieur d’une autre fiction, qui met en scène l’élaboration de la pièce par une troupe de théâtre et son auteur, le très américain Conrad Earp, qui n’est pas sans rappeler les grands écrivains du XXe siècle, Tennesse Williams, William Faulkner ou encore John Steinbeck. L’instance d’énonciation est mise en cause dès l’ouverture du film, où Bryan Cranston, en présentateur d’une émission bien étrange, matérialise la traditionnelle voix-off.
Comme beaucoup de grandes oeuvres, Asteroid City s’élabore autour d’un vide, autour d’un gouffre métaphysique, ici peur de la bombe, là véritable angoisse devant l’absurde, et peut-être devant le silence du ciel. Les centres de gravité de cette fiction pensante sont des absences, des manques, des silences : absence de l’épouse décédée et de l’actrice que la pièce a oublié, absurde de la situation et mystère de l’apparition de l’alien et de son comportement. Les enfants géniaux éprouvent pour la première fois l’absurde, ce qui remet en question leurs inventions en même temps que leur foi. Autour de la singularité, il rejouent l’étonnement ontologique de 2001, revivent en eux-même l’humanité, c’est à dire qu’ils ressentent leur être en dehors d’une situation, qu’ils s’arrachent à l’histoire et à la société pour contempler leur existence pure, cette formule de quelque chose : de Dieu, du hasard, de l’atome, du big bang, du phénomène. Enfant de la catastrophe, l’homme moderne retrouve le vertige devant les exploits de l’intelligence. Et le langage, ce véhicule de la pensée qui n’est pas elle mais dont elle a besoin, emprunte le chemin de l’abstraction : comme dans Rencontres du troisième type, la communication se radicalise mais se débarrasse du lyrisme initié par Spielberg pour confronter l’idée rationnelle, la langue mathématique, et offrir son vaisseau au style du cinéaste, qui enfouit depuis toujours le secret et la déchirure, ce qu’il est convenu d’appeler l’émotion, dans les ultimes replis de ses images hygiéniques, et dont l’humanité émerge comme une blessure.
Qu’au coeur du film les phénomènes, parce que c’est de phénomènes qu’il est question, prennent tous une portée métaphysique d’où se déploient des interrogations primordiales n’empêche en rien leur solide existence narrative, leur puissance d’être dans la fiction, leur élégance, leur étonnante alchimie avec ce style qu’Anderson radicalise jusqu’à retrouver, en un mouvement d’épure bienvenu, l’écho d’un vaste imaginaire.
Comme cela sera mentionné à peu près partout, du moins nous le pensons, et comme nous l’avons déjà dit, c’est l’écho de Rencontres du troisième type, des cartoons, de 2001 l’Odyssée de l’espace et une vision prémonitoire d’Oppenheimer qui forment l’arrière-plan mental d’Asteroid City. Mais ce chantier, cette gravitation dans le désert ne saurait être une seule et même histoire, bardée de références, et ce serait oublier, si l’on en faisait un film à un unique étage, la forme de son scénario, fascinante entreprise d’imbrication qui, sans déconstruire la fiction, l’épaissit. Si Asteroid City est une ville de fiction dans la fiction, elle est la singularité, le coeur imaginaire d’une Amérique pour qui le désert fut un lieu d’angoisse et d’apparition, une zone hantée par la peur de l’extra-terrestre, la catastrophe atomique, la conquête de l’Ouest, ramené ici à son essence, comme épuisé par une nouvelle histoire.
Alors, la mise en scène peut charrier ses fantômes, et emprunter l’image d’un silence dans la catastrophe à Edward Hopper, réveiller par le pastiche le western fordien et happer dans son style la forme du cartoon. Invincible, cette matrice du désert célèbre ses mythes qui sont aussi, et peut-être avant tout, ceux d’une ère médiatique : mythologie de la télévision, de l’information, même fausse, comme le ressac incessant de la Guerre Froide.
Mais l’Auteur, mais l’intelligence s’extraient au désert et à la lumière pure, ni chaude, ni froide, du théâtre de l’angoisse, pour se reloger dans la chambre de l’intime : ce noir et blanc qui se transcende et passe de la formule médiatique et télévisuelle à l’incarnation d’une intériorité pétrie de solitude et lacérée par l’amour. Conrad Earp est l’artiste en lutte avec le désir d’ordre et de sens, ce personnage inventé par la modernité qui s’est enrichi de toute les catastrophes, et dont l’angoisse remonte du désert vers le cerveau, de l’objet vers l’abstrait, comme une conquête du doute, une exploration méticuleuse et déchirante des gouffres qui sont pour l’art les seuls refuges. Et tous les membres de la troupe, du metteur en scène aux acteurs, traînent dans l’espace filmique mis en vignettes leur plus profondes béances. C’est la pièce qui les confronte et les oblige à remuer en eux-même, à s’envahir de peine, par quoi ils deviennent leurs personnages, réussissent l’opération alchimique de l’art et effacent le faux qui semblait être le lot du film, avec ses tiroirs, sa métadiégèse et son décor factice planté dans le désert. Tout cela, ce faux qui n’est rien, cette petite matière, est investi par les inaltérables vérités de l’amour, et par l’angoisse initiale, devenue l’argile de l’homme moderne.
Et Saint-John Perse de triompher dans notre mémoire :
« Mais plus que mode de connaissance, la poésie est d’abord mode de vie – et de vie intégrale. Le poète existait dans l’homme des cavernes, il existera dans l’homme des âges atomiques parce qu’il est part irréductible de l’homme. De l’exigence poétique, exigence spirituelle, sont nées les religions elles-mêmes, et par la grâce poétique, l’étincelle du divin vit à jamais dans le silex humain. Quand les mythologies s’effondrent, c’est dans la poésie que trouve refuge le divin; peut-être même son relais. Et jusque dans l’ordre social et l’immédiat humain, quand les Porteuses de pain de l’antique cortège cèdent le pas aux Porteuses de flambeaux, c’est à l’imagination poétique que s’allume encore la haute passion des peuples en quête de clarté. »
La poésie se tient dans la fissure, ce petit geste qui rompt la monotonie des plans cliniques. Elle existe dans l’instant arraché au cours de l’histoire : la photographie. Et c’est ici un axiome, et une belle réflexion sur son propre cinéma que propose Anderson quand il tire ses plans vers la singularité, comme le désert se concentre dans l’astéroïde, en les offrant à la radiation du noir et blanc, somme de moments qui retirent du plan autre chose que gimmick ou style. Toutes les photographies d’Augie Steenbeck sont réussies parce qu’elles sont pour lui (et pour nous) un relai devant le silence et l’absurde. Enfin, Asteroid City est un traité. C’est pour Wes Anderson l’occasion de nous offrir furtivement de quoi redéfinir un style trop souvent décrit en surface. S’il est bien question de vernis dans ces images, c’est qu’elles peuvent se marquer un peu ; et c’est assez pour dire l’essentiel des plaintes : contre les défaites du langage, l’inépuisable matière de l’image saura toujours garder en elle notre mélancolie.
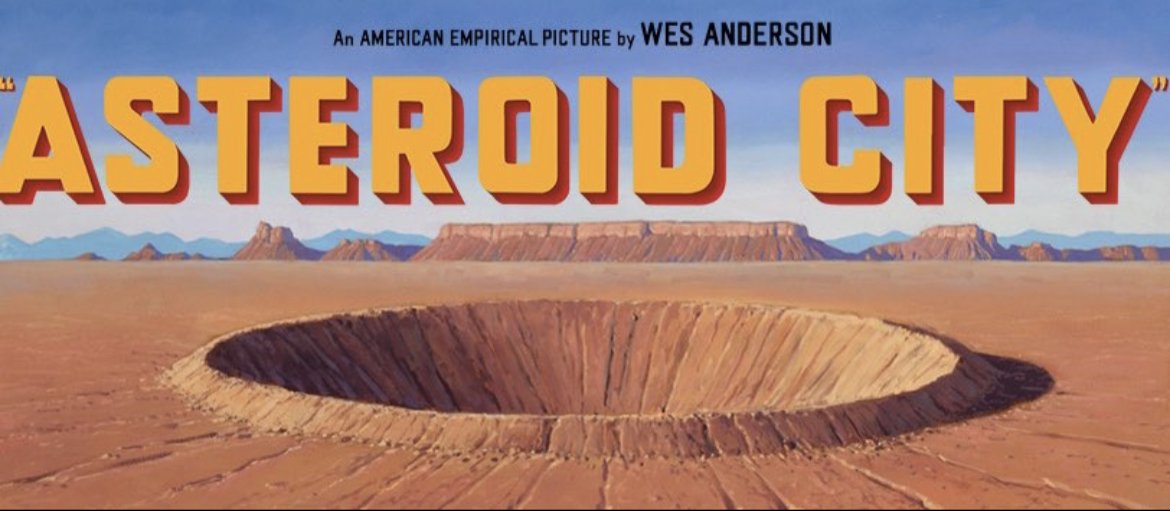
Laisser un commentaire